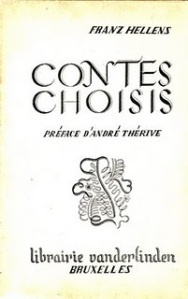Réalisation : Franck Richard
Scénario : Franck Richard
Pays : France pis Belgique
Sortie : 2010 en France, 2011 en Amérique du Nord
J’avais hâte de le voir depuis que je l’ai raté à Fantasia l’année passée. Maintenant qu’y est sorti en DVD, j’ai réussi à le downloader. Les critiques avaient été bonnes, en général, pis un film à moitié belge, ça permet d’espérer des trucs bizarres, comme dans Calvaire ou C’est arrivé près de chez vous.
Résumé
C’est l’histoire de Charlotte, une jeune femme qui fait un road-trip toute seule sans vraiment de destination. Elle pogne un gars sur le pouce, Max. Ensemble, y arrêtent dans un genre de bar crasseux nommé La Spack, tenu par une grosse madame du même nom. Dans le bar, Charlotte pi Max se font menacer pis presque violer par trois motards débiles. La Spack sort un shotgun, ben décidée à maintenir le calme dans son bar. Sauf que, quand Max revient pas des toilettes, Charlotte se met à le chercher. Elle sent que quelque chose de bizarre se trame. Après avoir parlé à un vieux policier, elle entre par effraction dans le bar louche. Mauvaise idée : elle se retrouve enfermée dans une cage par La Spack pis Max, qui s’avère être son fils. Charlotte essaye de s’enfuir pis le policier essaye de la retrouver. Finalement, par un soir de tempête, La Spack accroche Charlotte sur un genre de potence pour la saigner en disant « La terre a besoin de sang ». C’est là que les zombies arrivent.
Critique
Le film commence un peu comme un cool movie à la Tarantino, avec des dialogues ben écrits pis des répliques cinglantes. Charlotte est un peu stéréotypée, genre fille forte qui écoute du métal pis qui a le sens de la répartie, mais le personnage réussit à être pas trop cliché, notamment grâce à son humour noir (la joke du zoophile, du sadique, de l’assassin, du nécrophile, du pyromane pi du masochiste). Pis elle est vraiment badass, comme quand elle boit son café après que le motard ait craché dedans pour l’intimider. Émilie Dequenne réussit à bien rendre la panique de Charlotte quand elle est enfermée.
En général, j’ai ben aimé les dialogues, surtout les répliques des motards, qui me faisaient rire à chaque fois. Exemple : « Chérie j’dois pisser, tu peux m’la tenir ? Mon médecin m’interdit d’porter des objets lourds. » C’est du génie. Ou ben Charlotte qui dit à Max : « J’te préviens, si tu sors ta bite ou quelque chose dans le genre, tu mange un bouquet de phalanges. » Max répond : « T’inquiète, fait trop froid. » Même si c’est pas réaliste, au moins, c’est drôle. Pis le ton est maintenu tout le long du film. Pis aussi « Va falloir éclater des mecs. Ça vous dirait, les tapettes ? »
Le personnage de La Spack est quand même cool, genre vieille campagnarde qui en a vu d’autres. Pi le policier trop wise est cool aussi, un peu à la Colombo, surtout avec son chandail Fuck on first date pis sa joke de faire des bruits de cheval quand y prend son vélo.
L’atmosphère vraiment crasse est réussie pis elle nous fait sentir sale pis toute – ça rappelle beaucoup Calvaire. On se sent encore plus mal vu qu’on sait pas trop où (on a aucune indication de lieu), ni quand ça se passe (aucune indication de temps). En fait, j’ai trouvé que ça avait des allures d’uchronie, surtout avec les personnages des motards qui font pas mal renégats-d’un-monde-post-apocalyptique, pis avec le décor style campagne retardée qui permet pas vraiment de se situer dans le temps. Anyway, tout ça, ça ajoute à notre malaise pis notre incompréhension.
J’ai entendu pas mal de critiques négatives à propos du scénario, mais j’ai pas trouvé particulièrement mauvais. Bon, on peut se demander pourquoi Charlotte essaye autant de retrouver Max, qu’elle vient tout juste de rencontrer, mais tsé. Contrairement à tout le monde, j’ai adoré le changement de ton drastique aux 2/3 du film, quand les zombies arrivent. Je m’attendais crissement pas à ça, pis j’ai été agréablement surpris.
La réalisation est paspire pantoute pis rend ben l’ambiance crade du décor. Les plans sont ben cadrés pis les mouvements de caméras sont intéressants. Par exemple, j’ai aimé l’ellipse quand on voit le policier rentrer chez La Spack : le plan coupe pis enchaîne sur La Spack qui ressort avec le policier dans une brouette. C’est nice comme montage, mais ensuite on nous sert un flashback qui explique comment ça c’est passé. Fucking maladroit.
Le film a des défauts : j’ai trouvé complètement inutile toute l’histoire des mineurs morts sous la terre qui sert à justifier l’existence des zombies. Surtout le bout où Charlotte tombe sur des vieux journaux, c’était crissement pas nécessaire. Ça aurait été mieux sans aucune explication. Aussi, dans la scène de l’attaque sur la petite cabane, les quatres zombies restent constamment au même endroit, comme si c’était fait pour qu’on puisse les voir à travers la fenêtre. Pas bon du tout. Pis on aurait vraiment pu se passer du sang qui dégouline dans l’objectif à la toute fin.
Le gore est quand même paspire, même si y en a pas tant. Les zombies sont assez forts pour démembrer un homme sans forcer. La scène de la torture sur la chaise est pas nice pantoute, même si elle est pas gore. Pis la fin est vraiment bad, dans le sens qu’elle nous fait pas sentir ben. J’avoue que j’ai été surpris que ça finisse aussi mal, pi j’étais triste pour Charlotte. Je l’aimais ben, finalement.
Analyse
« La victime fantastique est donc un être déterritorialisé. » C’est ce qu’écrit André Carpentier dans son article L’espace fantastique comme variété de l’espace vécu. Y me semble que ce mot-là – déterritorialisé – qualifie ben Charlotte. Elle évolue, comme le spectateur, dans un monde qui propose aucun point de repère temporel ou spacial. En plus, elle a pas vraiment de but : au début, elle dit à Max qu’elle roule jusqu’à la fin de ses CDs. Le film s’ouvre sur des longs plans de routes perdues dans le brouillard. D’emblée, on sait qu’on se trouve dans le trou-du-cul-du-monde, un lieu isolé, éloigné de la civilisation pis de ses règles. Cette idée d’égarement est présente chez Charlotte elle-même, qui a pas de passé, pis encore moins de futur. Tout ce qu’on sait d’elle, c’est ce qu’elle aime écouter les problèmes de gens, que ça la dope. On peut peut-être en déduire qu’elle aussi a des problèmes, pis qu’écouter ceux des autres, ça l’aide à relativiser, ou au moins à se sentir moins seule dans sa marde. On découvre que plus ça va, plus Charlotte s’enfonce dans un univers crade pis dirt, qui la menace constamment pis qui ses déshumanise à mesure que le récit avance. Dès le début, y a les motards qui essayent de la violer, ensuite le policier qui l’avertit que c’est dangereux, pour une belle fille comme elle, de prendre des pouceux – ce qui s’avère vrai, ensuite la cage, La Spack a l’air invincible, pis ensuite les zombies. Charlotte passe de fille-forte à fille-captive-bétail à fille-captive-bouffe-pour-les-zombies. Elle aussi se déshumanise, comme si l’univers dans lequel est évolue l’avait contaminée. Tout le long de sa captivité, ses efforts pour communiquer sa détresse son vains; l’humanité est pas rejoignable. Tout le long du film, Charlotte se débat « sous la menace de l’étrange, soumise à la coupure ou au renoncement à tout principe de liberté. C’est pourquoi sa mésaventure, sa détresse paraissent irréversibles. Le maléfice n’est pas qu’au bout de son trajet; il l’accompagne tout au long de sa déambulation. » Le monde se referme peu à peu sur Charlotte pis y devient tellement hostile qu’y finit par la bouffer, au sens propre.
Pour résumé, Charlotte, c’est une espèce de Dante, mais sans personne pour la guider, qui réussit pas à se sortir de l’enfer.
Verdict
Recommandé. Même si c’est pas parfait, c’est un film surprenant pis ben réalisé (la plupart du temps). Les dialogues sont comiques pis malaisants en même temps, les personnages sont le fun pis les zombies sont vraiments laids, dans le bon sens du terme.